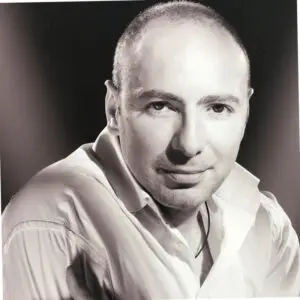Le terme « polypensionné » ou « multipensionné » est utilisé pour désigner toutes personnes qui ont cotisé auprès de plusieurs régimes de retraite au cours de leur carrière professionnelle et qui percevront ainsi plusieurs pensions une fois à la retraite.
Selon des données récentes, environ 50 % des nouveaux retraités en 2023 perçoivent plusieurs pensions de base, ce qui illustre la fréquence croissante des situations de polypensionnés. Il faut savoir que le système de retraite français est constitué de 35 régimes professionnels différents : entre autres la fonction publique, le régime général, le régime des exploitants agricoles, le régime social des indépendants, etc. Découvrez les informations suivantes pour mieux comprendre le calcul des retraites des polypensionnés.
Un zoom sur la situation des polypensionnés
Depuis la promulgation de la loi de réforme de 2003 instauré par le gouvernement de François Fillon, l’égalité de traitement entre tous les cotisants quel que soit leur parcours professionnel est devenu une règle : un traitement équitable au regard de la retraite pour tous les assurés quels que soient leurs activités et les régimes de retraite auprès desquels ils ont cotisé. Les autorités compétentes ont pris des dispositions pour que l’égalité de traitement soit mise en œuvre, mais jusqu’à présent, il reste encore des différences de traitement. Les polypensionnés reçoivent une pension globale calculée à partir des droits acquis dans chaque régime, mais depuis la réforme de 2014, pour les régimes alignés, un calcul unique est réalisé. Cependant, certains régimes non alignés continuent à verser des pensions spécifiques, qui s’ajoutent.
Il faut savoir que régimes de retraite français sont subdivisés en deux groupes bien distincts :– Les régimes alignés sur le régime général : le régime social des indépendants (RSI) qui regroupes les artisans, les commerçants et les industriels ; la Mutuelle Salarié Agricole (MSA) et le régime général des salariés (CNAV) ;
– Tous les autres régimes sont non alignés sur le régime général : il s’agit du régime de la fonction publique, du régime des professions libérales et des régimes spéciaux.
Les règles de calcul des pensions varient en fonction des régimes auprès desquels l’assuré cotise. Le montant des pensions dépend de la durée de cotisation et d’autres paramètres qu’il faut connaitre.
Le calcul de la retraite des polypensionnés
La réforme des retraites de 2023 a progressivement repoussé l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans entre 2023 et 2030, avec un allongement correspondant de la durée de cotisation. Les régimes spéciaux ont été supprimés depuis septembre 2023, ce qui réduit les exceptions en matière d’âge de départ anticipé. Certains agents de la Fonction publique peuvent également partir en retraite plus tôt par rapport aux assurés qui dépendent d’autres régimes. Les conditions d’âges sont différentes pour les régimes complémentaires des sections professionnelles des professions libérales.
Cet alignement s’est aussi appliqué à la plupart des régimes de retraite français. La durée d’assurance prise en compte pour le calcul de la retraite des polypensionnés est la somme de toutes les durées de cotisation auprès de chaque régime de base. Cependant, le nombre de trimestres acquis est toujours limité à 4 par an. Par exemple, si au cours de l’année 2005, l’assuré a été salarié à temps partiel et a également travaillé comme indépendant, il peut valider 4 trimestres auprès du régime général et 4 trimestres dans le régime des indépendants si ces deux activités lui permettent de gagner plus de 800 fois le SMIC horaire de l’année 2005, soit 6 448 euros.
Si l’assuré a droit à des majorations de trimestres pour enfants, elles ne sont attribuées qu’au titre d’un seul régime, le régime général en priorité ou bien le dernier régime auquel l’assuré a cotisé s’il n’a pas été affilié au régime général.
La réforme des retraites de 2014, appliquée depuis 2017, a mis en place un calcul unique du revenu annuel moyen basé sur les 25 meilleures années tous régimes alignés confondus, versé par un régime unique. Ce mode de calcul reste d’actualité, mais les conditions d’âge et de durée de cotisation ont évolué depuis. Mais avant la parution du décret d’application, les modalités de calcul sont les suivantes :
le salaire annuel moyen s’obtient à partir des 25 meilleures années de revenus pour les assurés qui ont cotisé auprès du régime général ou auprès d’un régime aligné. Ce mode de calcul est valable pour les assurés nés après 1947 et affilié au régime général et aux travailleurs nés après 1952 pour les artisans et les commerçants qui cotisent auprès du Régime social des indépendants. Ces règles de calcul peuvent être défavorables pour les retraités qui ont cotisé auprès de plusieurs régimes et deux cas peuvent se présenter :a) Lorsque l’assuré a cotisé auprès de plusieurs régimes alignés sur le régime de base au cours de sa carrière (CNAV, RSI, MSA salariés) :
Le nombre d’années de salaire retenues est réparti entre les régimes de manière proportionnelle à la durée de cotisation auprès de chaque caisse. Par exemple, pour une personne qui a validé 120 trimestres auprès du régime général et 60 trimestres auprès du RSI, le calcul de son salaire moyen s’effectue de la manière suivante :
-dans le régime général : 25 x 120 trimestres/180 trimestres = 16,66, arrondi à 17 années ; -dans le régime social des indépendants : 25 x 60 trimestres/180 trimestres = 8,33, arrondi à 8 années.Il faut noter que les 180 trimestres correspondent à la somme des durées de cotisations auprès des régimes. Il ne s’agit pas de la durée totale d’assurance requise pour toucher une retraite à taux plein.
b) Lorsque l’assuré a cotisé auprès d’un ou plusieurs régimes alignés et à un ou à plusieurs régimes non alignés :
-pour les régimes alignés : le calcul du revenu annuel moyen est obligatoirement basé sur les 25 meilleures années de salaire. Si l’assuré a travaillé pendant moins de 25 ans dans le régime, toutes les années cotisées sont retenues pour le calcul du revenu annuel moyen ;
–pour les régimes non alignés, il suffit d’appliquer le mode de calcul de la pension de retraite propre au régime (mode de calcul spécifique pour les régimes spéciaux, 75 % du traitement des 6 derniers mois pour les fonctionnaires et un calcul en points dans le régime des professions libérales). Par exemple, si l’assuré a validé 56 trimestres auprès du régime général en tant que salarié et 111 trimestres comme professionnel libéral, le calcul se fait en deux étapes :
Pour le régime de base : revenu annuel moyen x taux x (Trimestres acquis / Trimestres requis) Le taux maximal est égal à 50 % du revenu de base. Pour les professions libérales, il suffit de multiplier le nombre de points cumulés par la valeur annuelle du point au moment de la liquidation des droits à la retraite. (Nombre de points x Valeur annuelle du point).Le calcul de la retraite des fonctionnaires polypensionnées
Le cas des fonctionnaires polypensionnés est particulier : pour avoir droit à une pension, l’assuré doit justifier d’au moins deux ans d’activité au sein de la fonction publique. Si l’assuré a travaillé pendant moins de deux ans dans la fonction publique, sa pension est calculée comme celle d’un agent non titulaire de la fonction publique. Le mode de calcul pour les agents qui ont travaillé pendant moins de deux ans (quinze ans avant la réforme de 2010) est similaire à celle des salariés du privé et leur pension est servie par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Ils touchent aussi une pension complémentaire servie par l’IRCANTEC.
La durée minimale est de un an depuis 2008 (contre 15 ans auparavant) pour certains régimes spéciaux comme les régimes de retraite de la SNCF, des Industries électriques et gazières ou encore de la RATP.
Depuis la réforme des retraites de 2023, l’âge légal de départ est désormais de 64 ans progressivement, et la durée d’assurance requise est portée à 43 ans dès 2027. Cette réforme accroît les durées de cotisation nécessaires et s’applique à tous les régimes alignés. La suppression des régimes spéciaux limite aussi les disparités précédentes.
Les démarches pour faire sa demande de retraite
Lorsque l’assuré souhaite cesser ses activités, il doit faire sa demande de retraite en bonne et due forme. S’il a cotisé auprès de plusieurs régimes alignés comme la CNAV, le RSI et la MSA salarié, il suffit de faire une seule demande auprès de son dernier régime de retraite. Les responsables de ce régime transmettront sa demande aux autres caisses de retraite.
En revanche, s’il a cotisé auprès de régimes autres que les régimes alignés, il faut faire une demande auprès de chacune des caisses correspondantes. Pour les retraites complémentaires, l’assuré doit faire une demande pour chaque caisse, sauf pour l’Agirc et l’Arrco où une seule demande suffit pour liquider ses droits à la retraite.Avant de déposer sa ou ses demandes de retraite, il est fortement recommandé de faire une simulation en utilisant le simulateur en ligne de retraite.com pour connaitre le montant de sa pension. En bénéficiant d’un entretien information retraite, chaque assuré peut connaitre toutes les alternatives qui s’offrent à lui pour améliorer le montant de sa pension. En effet, les experts effectuent des analyses personnalisées pour aider les particuliers à bien préparer leur départ.