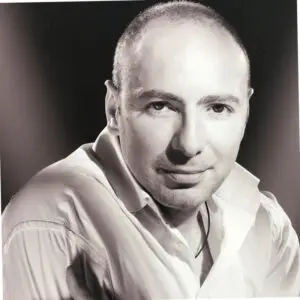Après les retraites, les premières politiques vieillesse des années 1960 ont surtout porté sur les “modes de vie” des personnes âgées permettant de prolonger une vie indépendante le plus longtemps possible. Puis à partir des années 80 et 90, elles se sont concentrées sur la question de la
prise en charge de la dépendance.Alors qu’on n’en finit pas de procrastiner autour des réformes qui permettraient d’anticiper la vertigineuse accélération du vieillissement de la population qui se profile, les années 2000 marquent la consolidation d’un système complexe d’aide et prise en charge des personnes âgées en France. C’est à cette époque-là, en effet, que sont votées les principales lois qui vont organiser ce système.
Les années 2000 : les lois majeures et la question éthique
A partir des années 2000, l’action publique va se consolider avec plusieurs lois majeures qui vont aboutir à des avancées importantes.
Les années 2000, c’est aussi le choc de la canicule de 2003 qui révéla au grand jour la problématique de l’isolement et de l’exclusion sociale d’un grand nombre de personnes âgées. Des mesures s’ensuivent pour soutenir le financement des actions au bénéfice des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment la création de la Journée de solidarité et de la Caisse nationale de solidarité autonomie (CNSA) pour administrer – entre autres – ces nouveaux fonds.
Les années 2000, c’est aussi la consolidation de l’arsenal déontologique visant à garantir les droits des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap. Deux grandes lois sont alors adoptées [1] avec en trame de fond la volonté de faire converger les politiques à destination de ces deux types de publics. Tout désavantage social associé à une incapacité mériterait finalement un traitement similaire quel que soit l’âge des personnes.
Les années 2010- 2020 : une société de la longévité en suspens
Après cette phase de consolidation des politiques vieillesse au cours de la décennie 2000, démarre celle de la métamorphose pour une société de la longévité. Même si pour l’heure, la métamorphose est restée au stade de chrysalide, c’est bien la dynamique qui est engagée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV.
Il ne s’agit plus seulement d’établir une politique vieillesse mais d’injecter dans l’ensemble des politiques publiques la nécessaire prise en compte du vieillissement de la population. Ce vieillissement est tel qu’il imprègne tous les segments de la société. Il doit donc être au centre des décisions en matière d’habitat, de transports, de santé, de travail, etc.
Bien que les moyens déployés n’aient pas permis finalement cette métamorphose sociétale, la loi ASV est une loi qui amorce un tournant symbolique. Symbolique dans la prise de conscience de l’accélération du vieillissement démographique. Symbolique aussi dans la remise en lumière des principes du rapport Laroque et de la priorité à donner aux actions de prévention et de participation sociale, via notamment la lutte contre l’isolement et l’amélioration de l’habitat. Symbolique aussi dans la reconnaissance du rôle des proches aidants de personnes âgées, dans un effort – malheureusement alors non abouti – d’accès à certains droits et dispositifs de soutien.
Depuis, la réforme grand âge et autonomie a fait l’objet d’avancées politiques, mais reste un chantier complexe toujours en cours d’élaboration en 2025. Par ailleurs, la réforme des retraites de 2023-2025 a introduit plusieurs changements majeurs impactant le départ à la retraite et la prise en charge des personnes âgées.
La crise sanitaire Covid-19, si elle a révélé des besoins importants dans l’accompagnement des personnes âgées dépendantes, a également impulsé une accélération de certains projets législatifs et réformes visant à améliorer leurs conditions de vie et le système de retraite (voir notamment la loi et les réformes en 2023 et 2024).
À noter également que la retraite progressive, initialement accessible dans des conditions variables selon l’année de naissance, sera désormais accessible dès 60 ans à partir du 1er septembre 2025, suite aux récentes réformes visant à favoriser une transition professionnelle plus souple (décrets du 23 juillet 2025).
Véronique Cayado
Docteure en psychologie
Institut Oui Care
________________________________________
[1] Il s’agit de la loi du 2 janvier 2002, dite la loi 2002-2 qui rénove la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; et de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.