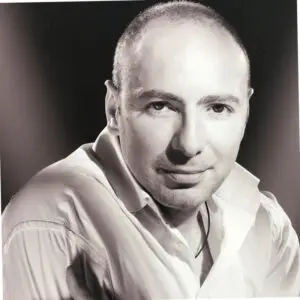La MSA s’occupe de tout ce qui touche à la protection sociale de base des salariés et des non-salariés agricoles. Les agriculteurs cotisent tous auprès des caisses de la MSA pour leur retraite. Cet organisme regroupe ses affiliés dans deux régimes différents à savoir le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles, de leurs conjoints et des aides familiales.
La retraite de base des agriculteurs
Les agriculteurs non salariés cotisent auprès de la MSA pour se constituer une retraite de base composée d’une retraite forfaitaire et d’une retraite proportionnelle. Le montant maximal annuel de la pension de base des agriculteurs a été revalorisé depuis 2013. Actuellement, la retraite de base des agriculteurs non salariés est plafonnée à 85 % du SMIC net agricole, soit une garantie minimale de retraite de 1200,26 € par mois en 2025, avec un plafond ajusté en lien avec l’évolution du SMIC et du plafond de la Sécurité sociale. Le montant total de la retraite de base ne doit pas dépasser cette limite, qui remplace la référence de 2013.
Depuis la réforme de 2025, le régime de retraite agricole est unifié en une retraite unique par points, intégrant la totalité des droits acquis. Cette réforme améliore la revalorisation des petites pensions avec un minimum garanti de 85 % du SMIC net agricole, et facilite la validation des trimestres d’aide familiale. Elle vise à assurer une meilleure protection sociale aux exploitants agricoles, notamment ceux ayant des carrières hachées ou précaires.
1. Comment bénéficier du taux plein ?
a)Les conditions de base
Si l’agriculteur non salarié veut toucher une retraite de base à taux plein, il doit choisir entre les options suivantes :
– Attendre l’âge légal du taux plein qui varie de 65 ans à 67 ans selon leur date de naissance ;
– Partir à l’âge légal de départ à la retraite (entre 60 ans et 62 ans) en cas d’inaptitude au travail. Cette prérogative concerné également les anciens combattants ;
– Avoir entre l’âge légal de départ et l’âge légal du taux plein pour les assurés qui ont validé un nombre de trimestres suffisant tous régimes confondus.
b)Les autres conditions
D’autres cas peuvent également permettre de prétendre à une pension à taux plein à 65 ans quelle que soit le nombre de trimestres cumulés au cours de leur carrière :
– Les personnes qui ont arrêté leur carrière pour devenir aide familial (assister un membre de la famille handicapé) ;
– Les assurés invalides ;
– Les assurés ayant un enfant handicapé ;
– Les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et la fin de l’année 1955 qui ont donné naissance ou élevé 3 enfants, s’ils remplissent certaines conditions.
c)Tableau récapitulatif
Le tableau suivant résume l’âge légal de départ et l’âge légal du taux plein en fonction de la date de naissance des assurés :
| Date de naissance | Âge minimum de départ | Âge minimum du taux plein |
| Avant le 1er juillet 1951 | 60 ans | 65 ans |
| 2e semestre 1951 | 60 ans et 4 mois | 65 ans et 4 mois |
| 1952 | 60 ans et 8 mois | 65 ans et 8 mois |
| 1953 | 61 ans | 66 ans |
| 1954 | 61 ans et 4 mois | 66 ans et 4 mois |
| 1955 | 61 ans et 8 mois | 66 ans et 8 mois |
| 1956 | 62 ans | 67 ans |
La retraite forfaitaire
La retraite forfaitaire dépend de la durée d’activité agricole tandis que la retraite proportionnelle varie selon le nombre d’années de cotisations.
Peuvent prétendre à la retraite forfaitaire :
– Les chefs d’exploitation ;
– Les chefs d’entreprises agricoles ;
– Les co-exploitants ;
– Les conjoints collaborateurs ;
– Les conjoints d’exploitants qui contribuent ou qui ont contribué à l’amélioration de l’exploitation ;
– Les aides familiaux.
Pour les assurés qui ont cumulé un nombre de trimestres suffisant, la retraite forfaitaire est aujourd’hui plafonnée à un montant recalculé et indexé régulièrement. Depuis 2025, elle est ajustée dans le cadre de la réforme des retraites agricoles, notamment par la revalorisation des petites retraites et la garantie d’un minimum de pension à 85 % du SMIC net agricole (soit environ 1200,26 € par mois). Ce montant remplace celui de 2013, qui est désormais obsolète. Lorsque la durée de cotisation n’est pas suffisante, la retraite de base est proratisée.
La formule à appliquer pour le calcul de la retraite forfaitaire est alors :
Retraite forfaitaire = Allocation aux Vieux Travailleurs Salariés x (durée de cotisation non salarié agricole/durée d’assurance requise pour le taux plein)
La retraite proportionnelle
La retraite proportionnelle est accordée :
– Aux chefs d’exploitation ;
– Aux aides familiaux depuis le 1er janvier 1994 ;
– Aux conjoints collaborateurs du chef d’exploitation depuis le 1er janvier 1999.
Si le nombre de trimestres requis pour le taux plein est atteint ou si l’assuré a atteint l’âge légal du taux plein, la formule qu’il faut appliquer pour trouver le montant de la retraite proportionnelle est la suivante :
Montant de la retraite proportionnelle = Nombre de points cumulés x Valeur du point en vigueur
Cependant, si le nombre de trimestres requis n’est pas atteint, le montant plein sera proratisé.
Remarques :
La retraite forfaitaire et la retraite proportionnelle peuvent être minorées, majorées ou encore plafonnées. Lorsque le nombre de trimestres requis n’est pas atteint, un taux de minoration de 1,25 % par trimestre manquant est appliqué. En revanche, si l’assuré a cumulé plus de trimestres, il profite d’une majoration de 1,25 % pour chaque trimestre supplémentaire.
Les parents ayant donné naissance ou ayant élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire peuvent bénéficier d’une majoration de 10 % sur leur retraite de base.
La retraite complémentaire des agriculteurs
La retraite complémentaire des salariés agriculteurs est gérée par l’Agirc-Arrco comme celle des salariés du privé, du commerce et de l’industrie. En revanche, les agriculteurs non salariés profitent depuis le 1er janvier 2003 d’une Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) gérée par la MSA.
1. La Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) gérée par la MSA
La Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) gérée par la MSA est un système de retraite par point. Les non-salariés agricoles versent des cotisations dont le montant est calculé sur la base d’un revenu minimal égal à 1 820 fois le SMIC horaire. Ces cotisations sont converties en points. Ils bénéficient de points gratuits pour les années d’activités précédant le 1er janvier 2003 s’ils ont cotisé pendant 17,5 ans en tant que chefs d’exploitation ou chefs d’entreprise agricole à titre exclusif ou à titre principal.
Pour trouver le montant de la retraite complémentaire, il faut d’appliquer la formule suivante :
Montant de la retraite complémentaire = Nombre de points cumulés x valeur du point en vigueur
2. Contribution des chefs d’exploitation
Depuis le début de l’année 2011, les chefs d’exploitation peuvent aussi cotiser pour les aides familiaux sur la base d’un revenu minimal égal à 1 200 fois le SMIC horaire. Les collaborateurs et les aides familiaux peuvent donc cumuler 66 points de retraite grâce à ces cotisations.
Grâce à cette retraite complémentaire, les agriculteurs non salariés touchent une retraite minimum (retraite de base + retraite complémentaire) égale à 75 % du SMIC net.
Où cotiser pour sa retraite ?
Les salariés et exploitants du secteur agricole en France cotisent à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). C’est l’organisme de protection sociale obligatoire des salariés et les non salariés du secteur agricole en France.
Qui cotise à la MSA ?
– Les chefs d’exploitation
– Les conjoints, parents, les enfants de plus de 18 ans
– Le concubin ou le partenaire de pacs doit choisir son statut (collaborateur, coexploitant ou salarié)
Comment calculer sa retraite ?
Depuis 2003, les exploitants agricoles bénéficient d’une retraite de base et d’une complémentaire obligatoire :
– La retraite forfaitaire : Ce type de retraite est réservé aux chefs d’exploitation.
Si le chef d’exploitation est né en 1952 et qu’il justifie de 164 semestres de cotisation, il bénéficiera du montant maximal.
– La retraite proportionnelle :
Cette retraite est calculée à partir des points acquis par cotisation. Pour les retraités ayant accompli toute leur carrière dans le secteur agricole, une pension minimum vieillesse leur est attribuée.
A quel âge partir en retraite ?
La réforme des retraites de 2010 a relevé l’âge légal de départ en retraite de 4 mois par génération. Les personnes nées en 1952 par exemple peuvent partir à la retraite à 6O ans et 9 mois.
L’âge auquel le taux plein est attribué progresse de la même façon. Le taux plein est automatiquement attribué à l’âge de 65 ans pour les personnes nées avant le 30 juin 1951.
Grâce à une action de revendication, les syndicats des travailleurs agricoles ont été entendus. Les autorités compétentes ont consenti à améliorer la pension des agriculteurs à la retraite.
Selon Francis Annequin, le président de la section des retraités de la FDSEA de l’Isère, lorsqu’un agriculteur cotise pendant une carrière complète, il touche une pension qui est de 7 % à 8 % inférieure au minimum vieillesse, c’est-à-dire, inférieure à 750 euros par mois.
Les faibles pensions des retraités agricoles
Les agriculteurs à la retraite touchent presque souvent de petites pensions parce que les exploitants vivent avec de faibles revenus. En Isère, il y a près de 15 000 retraités qui reçoivent une pension agricole et seuls 5 000 à 6 000 d’entre eux ont pu justifier d’une carrière complète. Les responsables des caisses de retraite agricole ont indiqué qu’il n’y a pas plus de dix assurés qui perçoivent une pension de plus de 1 000 euros.
Ainsi, pour survivre à leur situation économique, les retraités agricoles sont nombreux à continuer à travailler. Ils cultivent un jardin potager pour réduire le budget qu’ils doivent consacrer à leur alimentation. Toutefois, certains d’entre eux s’étaient mieux préparés en économisant tout au long de leur carrière et touchent actuellement une retraite plus confortable comparée aux 750 euros à 800 euros de retraite mensuelle.
Des actions syndicales qui ont été entendues
Les syndicats se sont mobilisés pour réclamer une pension minimale égale à 75 % du SMIC d’ici 2017 pour les agriculteurs qui auront accompli une carrière complète. Ces revendications ont été entendues et le président François Hollande a tenu ses promesses de campagne présidentielle de 2012. Si les agriculteurs à la retraite perçoivent actuellement des pensions inférieures de 40 % à la moyenne nationale, une disposition de la loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014 va changer cette situation.
Une hausse progressive jusqu’en 2017
La nouvelle loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014 prévoit quatre mesures essentielles qui concernent les retraites agricoles, mais la plus importante est sans doute le montant minimum de la retraite des agriculteurs qui ne pourra plus être inférieur à 75 % du SMIC (contre 50 % du SMIC actuellement). Il faut noter que cette hausse sera progressive et sera effective en 2017.