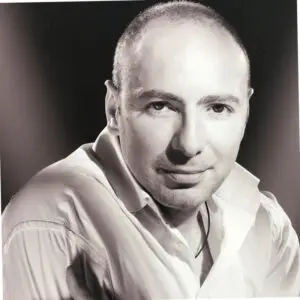Les footballeurs professionnels ont droit à une retraite selon le régime général de Sécurité sociale. La retraite des footballeurs concerne également tous les travailleurs du foot. Le cumul emploi-retraite est une option pour les footballeurs à la retraite, suivant les conditions prévues par la loi.
Le statut de footballeur
Si le footballeur professionnel a aujourd’hui un statut bien défini, c’est grâce aux actions d’un syndicat : l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) qui a été fondée en novembre 1961 par Maitre Jacques BERTRAND, Eugène N’ JO LÉA et Just FONTAINE. La charte du football professionnel a été mise en place en 1973. Le statut défini par la Convention collective nationale des métiers du football (CCNMF) est applicable aux footballeurs professionnels, aux stagiaires, aux espoirs, aux aspirants et aux élites.
Depuis 2012, un dispositif spécifique de retraite financé par l’État permet la prise en compte jusqu’à 16 trimestres (et désormais jusqu’à 32 trimestres depuis 2024) pour les périodes d’inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau, complétant ainsi les droits des footballeurs professionnels au régime général[2].
La retraite de base des footballeurs professionnels
L’article L 311-2 du code de la Sécurité sociale stipule que « toute personne, quelle que soit sa nationalité, son sexe, salarié ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, et quel que soit le montant et la nature de la rémunération, la forme, la nature ou la validité du contrat, est assujetti au régime général de sécurité sociale ». Ainsi, le footballeur qui touche une rémunération versée par un club en contrepartie de certaines obligations (entrainements, matches, activités, etc.) peut cotiser auprès du régime général.
a) Base de calcul des cotisations
Le montant des cotisations est calculé sur la base de la totalité des revenus découlant d’un emploi. Il faut savoir que, depuis la mise à jour récente du régime des retraites des sportifs, certaines rémunérations liées à la commercialisation de l’image collective peuvent, dans des conditions spécifiques, être prises en compte pour le calcul des droits à la retraite, notamment dans le cadre du dispositif de retraite des sportifs de haut niveau qui prend en charge jusqu’à 32 trimestres depuis 2024[2].
b) Les taux de cotisations des footballeurs sont les mêmes que ceux des salariés du privé :
– 14,95 % des revenus dans la limite du Plafond de la Sécurité sociale : la part patronale est de 8,30 % et celle de l’employé est de 6,65 % ;
– L’employeur s’acquitte aussi de 1,60 % et le salarié paye 0,10 % sur la totalité de ses revenus.
Les cotisations donnent droit à des trimestres qui permettent de calculer le montant de la pension de base à la fin de la carrière du joueur.
c) Calcul de la pension
Pour trouver le montant de la retraite, il faut appliquer la formule suivante :
Pension de base = Revenu annuel moyen x taux de référence x (Durée de cotisation/Durée de cotisation requise)
En principe, le revenu annuel moyen est calculé sur la base des 25 meilleures années de salaires. Si la durée de cotisation totale est inférieure à 25 ans, toutes les années de la carrière de l’assuré seront prises en compte.
Les conditions à remplir pour pouvoir partir à la retraite
Le footballeur doit remplir certaines conditions pour pouvoir liquider ses droits à la retraite :
Le footballeur doit remplir certaines conditions pour pouvoir liquider ses droits à la retraite : D’une part, il lui faut atteindre l’âge légal de départ en fonction de sa date de naissance (généralement entre 62 ans et 67 ans en fonction des réformes récentes). Une carrière longue peut permettre un départ anticipé à 60 ans, notamment pour les joueurs ayant commencé avant 20 ans. Les conditions exactes évoluent selon les dernières réformes des retraites[1][2].
Cumul emploi-retraite
Avec le dispositif de cumul emploi-retraite, l’assuré peut reprendre une activité salariée s’il remplit les conditions imposées par la loi. Le footballeur pourra alors se reconvertir dans un autre emploi qui relève d’un autre régime de retraite. Pour ce faire, il doit donc produire une attestation sur l’honneur qui précise la date exacte de cessation d’activité.
La retraite complémentaire des footballeurs professionnels
La retraite complémentaire des footballeurs professionnels Le footballeur professionnel cotise à l’Arrco (et à l’Agirc-Arrco depuis la fusion de ces régimes en 2019) pour se constituer une retraite complémentaire au cours de sa carrière[1].
a) Conditions d’obtention de la retraite complémentaire
En général, l’assuré demande sa pension complémentaire en même temps que la retraite de base, au moment de l’âge légal de départ à la retraite (de 60 ans à 62 ans en fonction de sa date de naissance) s’il a cumulé un nombre de trimestres suffisants pour toucher le taux plein.
En cas de carrière longue ou de handicap, il est possible de partir à 60 ans. Si le nombre de trimestres requis pour le taux plein n’est pas atteint et que l’assuré souhaite quand même faire sa demande de retraite dès qu’il a l’âge légal de départ, un coefficient de minoration sera appliqué.
b) Un système par points
En principe, le revenu annuel moyen est calculé sur la base des 25 meilleures années de salaires (pour le régime général). Toutefois, pour les footballeurs dont la carrière est souvent courte, l’ensemble des années validées est pris en compte. Cette méthode n’a pas changé mais la prise en compte du dispositif de retraite des sportifs de haut niveau modifie certains calculs par compensation d’Etat[1][2].
Remarque : L’Arrco peut aussi attribuer des points gratuits pour certaines périodes, entre autres :
- La maladie, la maternité, l’accident de travail, l’invalidité au-delà de 60 jours consécutifs ;
- Une activité au sein d’une entreprise qui n’a pas cotisé auprès de l’Arrco parce que ce n’était pas obligatoire à l’époque ;
- Le service national ;
- Les périodes de chômage ou de préretraite indemnisées sous certaines conditions ;
- Les périodes de chômage indemnisées par Pôle emploi
- Une période de détention provisoire qui n’a pas abouti à une condamnation.
Si la durée de cotisation ne permet pas de toucher le taux plein et que l’assuré n’a pas atteint l’âge du taux plein, un coefficient de minoration qui varie en fonction de l’âge de départ et du nombre de trimestres manquants sera appliqué pour le calcul du montant de la pension complémentaire à percevoir.