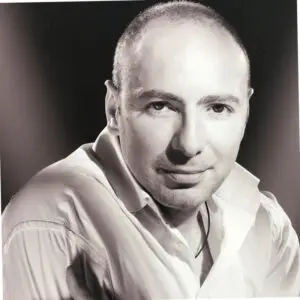Le calcul retraite des salariés se base sur la moyenne des salaires des 25 meilleures années. Cette règle est valable pour l’ensemble des salariés du secteur privé. En revanche vous devrez également prendre en compte le nombre de trimestre validés au cours de votre carrière pour espérer obtenir une retraite à taux plein.
Pour préparer votre retraite, il est important de répondre à 3 questions : A quel âge pourrais-je prendre ma retraite ? Quel sera le montant de ma pension ? et enfin quelles sont les solutions d’épargne retraite les plus adaptées à ma situation.
Retrouvez toute l’explication lié au calcul de sa retraite et simulez gratuitement votre situation en 2 minutes grâce à notre simulateur retraite gratuit
Faire une simulation gratuite de calcul retraite de salarié
- A quel âge pourrez vous partir en retraite ?
- Quel sera le montant de votre pension ?
- Quelles sont les meilleures solutions de retraite pour compenser ma perte de revenu
Retraite.com vous met à disposition un simulateur gratuit pour estimer l’âge et le montant de votre retraite
Le calcul de la retraite de base des salariés
Tout salarié est immatriculé à la caisse du régime général de la Sécurité sociale dès son premier emploi, mais cette immatriculation peut également se faire dès l’inscription au baccalauréat ou bien l’inscription dans une école d’enseignement supérieur. Les personnes immatriculées disposent d’un compte sur lequel les montants des salaires soumis à cotisations sont enregistrés. Rappelons qu’il suffit d’un trimestre de cotisation pour s’ouvrir des droits à pensions, cependant le montant de la pension est proportionnel à la durée de la carrière professionnelle parce qu’il dépend des paramètres suivants :
- La durée de la carrière professionnelle
- La durée de l’activité salariée
- La moyenne des 25 meilleures années de salaire de la carrière.
- Les réformes récentes ont renforcé le droit à l’information des salariés sur leurs droits à la retraite, notamment avec la mise en place du compte personnel retraite accessible en ligne sur le site officiel Info-retraite, qui permet de suivre en temps réel les droits acquis et d’estimer sa future pension.
Pour trouver le montant de la pension de base, il faut appliquer la formule suivante
Pension de base : Revenu Annuel Moyen x Taux applicable x (durée d’assurance / durée de référence)
Le revenu annuel moyen
Le revenu annuel moyen ou salaire annuel moyen est calculé à partir des 25 meilleures années de salaires bruts dans la limite du plafond de la Sécurité sociale de l’année en cours. Si le salarié a travaillé pendant une durée inférieure à 25 ans, toutes les années cotisées seront prises en compte dans le calcul du revenu annuel moyen. Si le salarié touche un revenu supérieur à ce plafond, sa retraite de base sera calculée à partir du seuil fixé par la Sécurité sociale. Des coefficients de revalorisation fixés tous les ans sont appliqués au moment de la liquidation des droits à la retraite pour considérer l’évolution des rémunérations au fil des années et de la progression des prix à la consommation.
Le taux applicable
Le taux maximal de la pension de base des salariés est fixé à 50 %. Le salarié qui a validé un nombre de trimestres suffisants et qui a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) ou l’âge du taux plein (67 ans) peut prétendre à une pension à taux plein. Si ces conditions ne sont pas remplies, une décote s’applique, réduisant le taux de la pension.
Depuis la réforme des retraites de 2014 et les réformes ultérieures, l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans pour les générations nées à partir de 1955 et l’âge du taux plein à 67 ans.
La durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein est allongée progressivement pour atteindre 172 trimestres (43 ans) pour les générations nées à partir de 1973. Ces dispositions s’appliquent actuellement et sont en vigueur sans modification annoncée majeure pour 2025.
Voici un tableau qui récapitule le nombre de trimestres requis, l’âge légal de départ et l’âge du taux plein :
| Année de naissance | Nombre de trimestres requis | Age légal de départ | Age du taux plein |
|---|---|---|---|
| 1952 | 164 | 60 ans et 8 mois | 65 ans et 8 mois |
| 1953 | 165 | 61 ans | 66 ans |
| 1954 | 165 | 61 ans et 4 mois | 66 ans et 4 mois |
| 1955 | 166 | 61 ans et 8 mois | 66 ans et 8 mois |
| 1956 | 166 | 62 ans | 67 ans |
| 1957 | 166 | 62 ans | 67 ans |
| 1958 | 167 | 62 ans | 67 ans |
| 1959 | 167 | 62 ans | 67 ans |
| 1960 | 167 | 62 ans | 67 ans |
| 1961 | 168 | 62 ans | 67 ans |
| 1962 | 168 | 62 ans | 67 ans |
| 1963 | 168 | 62 ans | 67 ans |
| 1964 | 169 | 62 ans | 67 ans |
| 1965 | 169 | 62 ans | 67 ans |
| 1966 | 169 | 62 ans | 67 ans |
| 1967 | 170 | 62 ans | 67 ans |
| 1968 | 170 | 62 ans | 67 ans |
| 1969 | 170 | 62 ans | 67 ans |
| 1970 | 171 | 62 ans | 67 ans |
| 1971 | 171 | 62 ans | 67 ans |
| 1972 | 171 | 62 ans | 67 ans |
| 1973 | 172 | 62 ans | 67 ans |
Bon à savoir : Il faut noter que les salariés atteints d’invalidité et les mères de trois enfants et plus peuvent, sous certaines conditions, partir à la retraite sans atteindre le nombre de trimestres requis et sans attendre l’âge légal du taux plein.
Si le salarié demande sa retraite avant l’âge du taux plein et sans avoir validé le nombre de trimestres requis pour le taux plein, le taux applicable à son revenu moyen sera minoré :
- La décote ou le coefficient de minorations applicable par trimestre manquant varie en fonction de l’année de naissance de l’assuré : il est de 0,6875 pour la génération 1952 et de 0,625 pour les personnes qui sont nées à partir de 1953.
- Il existe également un taux de liquidation minimal prévu par la loi fixant un plancher au montant de la pension de base, qui s’applique sous conditions. Ce taux minimal peut être modifié en fonction des réformes et doit être vérifié selon les dispositions en vigueur au moment du départ à la retraite.
Depuis le 1er janvier 2004, les salariés qui décident de continuer à travailler après l’âge légal de départ à la retraite même s’ils ont déjà validé un nombre de trimestres suffisant pour toucher une retraite à taux plein pourront profiter d’une surcote. Il s’agit d’une majoration de 1,25 % par trimestre supplémentaire.
Note importante : Depuis janvier 2025, le montant du minimum contributif est fixé à 777,20 € brut par mois, et il peut atteindre 893,66 € brut par mois si le nombre de trimestres requis est validé. De plus, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), destinée aux personnes aux faibles ressources, est également revalorisée en 2025. Ces dispositifs garantissent une retraite minimale aux salariés qui ont cotisé mais perçoivent une pension faible.
Compter les points cumulés au cours de sa carrière
Les salariés qui cotisent auprès des caisses complémentaires Agirc-Arrco disposent d’un compte individuel sur lequel les points acquis sont reportés. Chaque cotisant peut consulter le site de l’Agirc et de l’Arrco pour accéder à son relevé de points et connaitre le nombre de points acquis au cours de sa carrière professionnelle.
Outre les points accumulés par cotisations, les salariés peuvent également racheter des points pour leur retraite complémentaire : le rachat de points auprès de l’Agirc et de l’Arrco peut s’effectuer au même moment que le rachat de trimestres au titre des études supérieures dans le régime général. Par contre, le rachat de points au titre des années d’activités incomplètes n’est pas possible.
Chaque salarié peut acheter 70 points par année d’étude dans la limite de trois ans. Il est ainsi possible d’acquérir 210 points Arrco et 210 points Agirc à travers le rachat de points. La valeur du point augmente avec l’âge. Ainsi, il est recommandé de s’y prendre au plus tôt.
Il est aussi possible d’obtenir des points gratuits. L’Arrco accorde des points gratuits dans les cas suivants : maladie, maternité, service national, période de chômage ou de préretraite, années d’activités non-cotisées parce que ce n’était pas encore obligatoire à l’époque.
L’Agirc offre aussi des points gratuits pour les périodes d’emploi d’encadrement avant la création du régime ou avant sa date d’extension ; les périodes d’inactivités directement liées à une guerre ; les arrêts maladie, accident ou maternité d’au moins 60 jours consécutifs et accompagnés d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ou bien de pension d’invalidité ; les périodes de chômage indemnisées par Pôle emploi ou par l’État ; une période d’emprisonnement qui n’est pas suive de condamnation et le rappel sous les drapeaux.