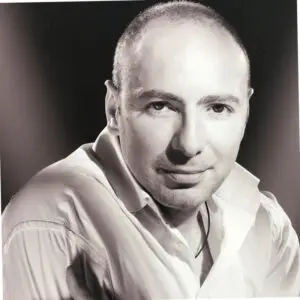Des comparaisons ont été faites et dénoncent des écarts, des chiffres révoltants pour ceux qui voient leur pouvoir d’achat baisser. Les particuliers regrettent que les hommes politiques ne participent pas à l’effort collectif indispensable pour rétablir l’équilibre économique du pays.
Des écarts révélés par une enquête récente
Lorsqu’un citoyen cotise 1 euro, il touchera une retraite de 1,5 euro s’il est salarié et une pension d’environ 2 euros s’il est fonctionnaire. Lorsqu’un parlementaire verse une cotisation de 1 euro, sa retraite s’élève à 6,1 euros.
Si les citoyens doivent travailler pendant 40 ans pour toucher une pension de 1129 euros, les députés peuvent y accéder en cotisant pendant 5 ans seulement. Face aux résultats de ces comparaisons, il faut constater que les personnalités politiques sont épargnées par les réformes et ne participent pas à l’effort collectif qu’ils demandent aux particuliers.
Aujourd’hui, un député perçoit une pension moyenne de 2700 euros nets par mois. L’âge d’ouverture des droits à pension a été relevé à 62 ans et 3 mois depuis septembre 2023, avec un relèvement progressif prévu pour atteindre 64 ans pour les générations les plus récentes.
La dernière réforme significative du régime de retraite des parlementaires date de 2010, avec une entrée en vigueur des nouvelles règles à compter de 2016 alignant progressivement les conditions sur celles du régime général.
Depuis, plusieurs ajustements ont eu lieu, notamment en 2017 et 2020, pour renforcer l’équité et la pérennité du régime. L’âge d’ouverture des droits à pension pour les députés est désormais de 62 ans et 3 mois depuis septembre 2023, avec une augmentation progressive jusqu’à 64 ans pour les générations les plus récentes. Le système de double cotisation a été supprimé, mais les taux de cotisation évoluent en fonction des mandats exercés, avec un taux de cotisation de 10,85% depuis 2020. Ces modifications visent à mieux aligner les députés sur le régime général tout en conservant certaines spécificités.
Fin de la double cotisation, mais une inégalité de financement
Depuis 2010, les députés peuvent cotiser 1,5 fois pendant leurs deux premiers mandats, puis 1,33 sur le troisième mandat et 1,25 sur tous les autres qui s’en suivent. Actuellement, après 5 ans de mandat, les députés peuvent toucher une retraite de 1129 euros contre 1500 euros avant 2010. Il y a donc eu une baisse de 24 %.
Cependant, les auteurs de cette étude dénoncent une inégalité de financement : les cotisations des députés ne couvrent que 12 % de la totalité des prestations versées par leur caisse de retraite. L’État leur accorde une subvention légale votée à l’Assemblée. Ainsi, les 52 millions indispensables pour payer la retraite des parlementaires sont à la charge des contribuables : selon cette étude, les citoyens payent 2376 euros sur les 2700 euros de retraite moyenne accordée aux députés. A titre informatif, les sénateurs touchent une pension moyenne de 4382 euros après la modification de 2010.
Depuis 2017, la réforme a supprimé le régime complémentaire facultatif et réduit la base de cotisation, conduisant à une meilleure équité avec les autres régimes. De plus, seuls les députés entrant en fonction pour leur premier mandat à compter du 1er janvier 2022 sont affiliés au système universel de retraite, tandis que les autres continuent dans le régime spécifique, ce qui maintient certaines spécificités du régime parlementaire.
Le régime de retraite des Députés s’inscrit dans un ensemble de dispositifs où chaque profession applique ses propres règles. Les différences observées entre les métiers de conducteur de taxi, de clerc ou employé de notaire, des conducteurs de train, des personnels de l’Éducation Nationale ou encore des travailleurs à domicile illustrent la diversité des statuts publics et privés, chacun doté de mécanismes adaptés aux réalités du métier exercé.