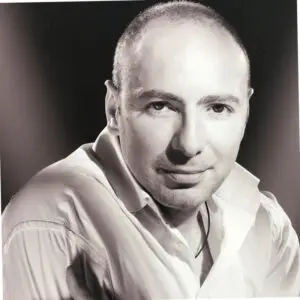La mise à la retraite est une disposition légale qui permet à l’employeur d’imposer un départ à la retraite à un salarié à partir de l’âge légal applicable, suite aux évolutions de la réforme des retraites de 2023, qui reporte l’âge légal à 64 ans, mais toujours sans possibilité de mise à la retraite forcée avant 70 ans.
La mise à la retraite est une disposition légale prévue par l’article L. 1237-5 du Code du travail. La loi du 17 décembre 2008 a reculé la mise en œuvre automatique à 70 ans. Toutefois, les réformes récentes, notamment la réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre 2023, ont modifié les âges légaux de départ en retraite, mais n’ont pas modifié le seuil de 70 ans concernant la mise à la retraite obligatoire par l’employeur.
Attention : Depuis la réforme des retraites de 2023, l’âge légal de départ recule progressivement, atteignant 64 ans pour un départ à taux plein en 2030, mais la possibilité pour l’employeur de mettre à la retraite un salarié à 70 ans reste maintenue. Il n’y a pas de possibilité de mise à la retraite forcée avant 70 ans.
Pas de recours pour les salariés mis à la retraite
La mise à la retraite est un mécanisme de rupture autoritaire de travail que l’employeur est en droit de ne pas justifier et que le salarié ne peut pas contester. Il faut noter que ce dispositif est bénéfique pour les salariés qui ont régulièrement cotisé pour se constituer des droits à la retraite et qui ont atteint le nombre de trimestres requis pour partir avec une pension à taux plein. En effet, il donne droit à des avantages fiscaux non négligeables.
Par contre, la mise à la retraite à 70 ans ne convient pas aux personnes qui n’ont eu droit qu’à une courte carrière professionnelle et à celles qui ont travaillé à l’étranger parce que leur pension est minime, et ce, même si elles perçevront également d’une retraite à taux plein.
La mise à la retraite, en harmonie avec la loi européenne
Les salariés qui ne souhaitent pas encore partir à la retraite cherchent toujours des moyens pour contester la décision de leur employeur en évoquant des textes légaux tels que la directive européenne concernant « l’égalité de traitement » : ils veulent assimiler la mise à la retraite à une discrimination se rapportant à l’âge.
Le 26 novembre 2013, la Cour de cassation a rectifié cette interprétation incorrecte : la mise à la retraite est une disposition conforme à la Constitution et elle est également en harmonie avec les lois qui régissent les activités au sein de l’Union européenne. En effet, la mise en retraite permet de réguler le marché de l’emploi et du travail. Par ailleurs, l’employeur n’a pas besoin de justifier la décision de mise en retraite du moment qu’il respecte les conditions légales.
Découvrez les démarches à suivre en cas de mise à la retraite d’un salarié. Quelques conseils pour la mise à la retraite d’un employé par un dirigeant d’entreprise.
La mise à la retraite d’un salarié par son employeur est une opération régie par des règles bien définies. Si le salarié peut demander sa retraite dès qu’il atteint l’âge légal de départ en retraite qui correspond à son âge, la mise à la retraite à l’initiative du chef d’entreprise ne peut se faire qu’à partir de 70 ans. Avant cette limite, le choix appartient toujours au salarié.
Les démarches en cas de mise à la retraite
Le salarié doit indiquer à son employeur la date de départ de son choix, trois mois à l’avance. Il a l’obligation de continuer à travailler au sein de l’entreprise jusqu’à cette échéance. L’employeur doit donner une attestation de cessation d’activité.
D’autres documents sont également indispensables pour que le salarié puisse faire sa déclaration : un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le dernier bulletin de paie. L’employeur ne doit pas oublier de mettre son registre personnel à jour.
De son côté, le salarié doit rendre les biens qui lui ont été remis dans le cadre de l’exercice de sa fonction (ordinateur, téléphone portable, véhicule, logement, etc.).
Les formalités financières
Le financement des cotisations vieillesse relève du régime de protection sociale applicable et est généralement réparti entre employeur et salarié selon les taux fixés par la réglementation en vigueur. L’employeur cotise en règle générale pour la totalité ou la majeure partie des contributions patronales, tandis que le salarié verse sa part salariale. Les modalités ne sont pas déterminées au moment de la signature du contrat de travail, mais dépendent de la législation sociale actuelle. Des sanctions sont prévues par la loi lorsque l’employeur faillit à l’obligation de verser la part de cotisation patronale qui lui incombe.
Les dirigeants d’entreprise doivent également accorder d’autres indemnités, selon les cas, à leurs salariés :
- L’indemnité de l’exécution de préavis ;
- L’indemnité de mise à la retraite ;
- L’indemnité compensatrice de congés payés ;
- Le prorata de primes et de gratifications ;
- Les heures supplémentaires ou le solde de repos compensateur ;
- Les soldes de jours RTT et la liquidation du compte épargne temps.
Note importante : Depuis le 1er septembre 2023, en application de la réforme des retraites, l’âge légal de départ est progressivement relevé, impactant la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein. Bien que la mise à la retraite forcée reste fixée à 70 ans, il est essentiel pour salariés et employeurs de bien se renseigner régulièrement sur les évolutions légales afin d’assurer une bonne conformité aux règles actuelles.
En savoir plus sur l’âge de la retraite
- Calculer l’âge de votre retraite
- L’âge legal de la retraite
- Âge pivot dans la réforme des retraites : Les gagnants et les perdants
- L’age à taux plein pour sa retraite
- Prendre sa retraite à 60 ans
- Conditions pour prendre sa retraite anticipée
- Comprendre les trimestres retraite
- Préparer sa retraite entre 27 et 45 ans
- Préparer sa retraite entre 45 et 55 ans
- Préparer sa retraite entre 55 et 67 ans